En quoi la recherche neuroscientifique s’impose-t-elle à l’école ?

Aujourd’hui, les neurosciences et l’école habitent une terre commune où chacun pense qu’une collaboration serait prometteuse pour les enseignants comme pour les élèves. L’école ne peut plus ignorer ce que l’on sait du fonctionnement du cerveau en situation d’apprentissage. Mais les recherches en neurosciences vont au-delà des connaissances neurologiques parce qu’elles vont s’adosser à l’intelligence artificielle. Cet avenir inconnu mais pressenti suppose que l’école peut aussi s’imposer à la science pour préserver sa vision humaniste de l’éducation.
Liens entre les neurosciences et l’école
Il était une fois une ville du nom de Babel dont les habitants, habités par le désir d’atteindre Dieu et de l’égaler, eurent le projet de bâtir une tour qui s’élèverait jusqu’au ciel. Babel, « babal » en hébreu, signifie « confondre », terme ambivalent qui veut dire à la fois « merveille » et « malédiction ». Étant donné que les bâtisseurs de la tour partageaient une même langue et un même dessein, rien ne pouvait plus les arrêter dans le désir de se mesurer à Dieu. Dieu entreprit alors de les disperser sur toutes les terres du monde et leur fit parler des langues différentes.
Pourquoi avoir voulu imposer aux hommes de ne plus parler la même langue ? Les interprétations sont très variées selon les cultures. J’ai retenu celle d’Emmanuel Levinas, pour qui ce mythe est une invitation à l’ouverture à l’Autre, celui qui est radicalement différent. Bien entendu, comprendre l’autre n’est pas seulement une question de linguistique. Erri de Luca, dans son ouvrage Noyau d’olive, publié en 2002, nous dit ceci : « Ce fut le projet de construction le plus grandiose de tous les temps, qui lui valut pour cela l’échec le plus fécond. L’humanité avait renoncé à tout désir, à tous les autres métiers. L’écriture dit qu’elle employait même des mots uniques. Elle était exclusivement concentrée sur une seule tâche, comme une société d’abeilles ou de fourmis. Dieu la détourna de cette impasse. On ne pouvait pas atteindre le ciel avec de la pierre et de la chaux ».

Dieu intervient par le don mystérieux des langues, qui nous contraint à apprendre de multiples façons, à nommer le même soleil, le même pain. Avec la multiplication des langues se multiplient les horizons. Il ne fallait plus monter au sommet du ciel pour survivre. Il ne fallait pas se retrancher dans une défense, mais se lancer dans l’aventure du monde. Dieu enseigne ici que plus elle est variée, plus elle met à l’épreuve et plus l’espèce humaine est forte. Par conséquent, toute tentative de proposer un seul sang, une seule nourriture, une seule médecine, va dans la mauvaise direction.
Les mythes sont de précieuses mémoires qui ramènent chacun de nous à son histoire personnelle et commune au sein de l’humanité : à son passé, mais aussi à son avenir. Dans le mythe de la tour de Babel, les hommes parlent tous la même langue pour réaliser le même projet, ce qui conduit à l’échec de l’œuvre, alors que la dispersion des humains dans des lieux différents et leur expression dans des langues différentes favorisent la coopération et une œuvre enrichie par sa diversité. Un projet de l’UNESCO est de faire dialoguer des cultures et de constituer une tribune de débats internationaux. La date anniversaire des droits de l’enfant marque également une extraordinaire œuvre commune des nations.
Nous décelons dans le mythe de Babel un rapport étroit avec le sujet qui nous occupe, en l’occurrence les liens favorables ou conflictuels entre les neurosciences et l’école.
L’édifice des sciences d’un côté et l’édifice de l’école de l’autre, sont-ils constitués comme des tours de Babel, ou sont-ils l’illustration de l’anti-Babel ? Où en est le dialogue entre ces champs disciplinaires en vue de faire œuvre commune ? Sommes-nous des bâtisseurs parlant la même langue ou des itinérants à l’épreuve de nos spécificités et de nos disparités ?
Faire cohabiter la science et l’éducation
Aujourd’hui, la science et l’éducation habitent chacune leur continent, mais chacune pressent bien qu’une collaboration serait prometteuse. Cependant, comme vous l’avez encore entendu ou lu dans la presse récemment, la recherche neuroscientifique sur le terrain scolaire demeure sujette à controverse. Certaines prises de position sont parfois radicales, tant de la part des scientifiques que des éducateurs. Ce phénomène s’observe depuis que l’école se sent investie dans son champ professionnel par des recherches invalidant parfois les théories à partir desquelles elle a formé ses enseignants, et dont certaines demeurent d’actualité.
Les arguments fusent de tous côtés : les uns soulignent que les élèves ne sont pas des « rats de laboratoire », les autres rétorquant que certaines théories de l’apprentissage faisant encore autorité sont obsolètes. Ces oppositions soulèvent la question suivante : où est le chaînon manquant qui rendrait cette rencontre possible ?
En ce début de XIXème siècle, l’école a connu deux ruptures épistémologiques concomitantes : l’arrivée des neurosciences d’une part, et la présence croissante de l’intelligence artificielle via la technologie numérique d’autre part. Ces deux ruptures, qui ont incité à porter un regard scientifique sur l’apprenant, ont conduit à en modifier les représentations, personnelles ou collectives. Les ruptures épistémologiques, selon Gaston Bachelard, s’envisagent comme des passages permettant d’aller vers de nouvelles connaissances. Dans son ouvrage La formation de l’esprit scientifique, il dit ceci : « Quand il se présente à la culture scientifique, l’esprit n’est jamais jeune. Il est même très vieux, car il a l’âge de ses préjugés. Accéder à la science, c’est spirituellement rajeunir, c’est accepter une mutation brusque sur ce qui doit être contredit du passé… »
Les neuroscientifiques qui se sont intéressés aux apprentissages scolaires le sont depuis peu, c’est-à-dire depuis leur participation au rapport de l’OCDE, qui s’intitule « Comprendre les cerveaux, naissance d’une science de l’apprentissage ». Depuis Broca, les neurosciences ont été traversées par différents courants. Les plus récents sont le behaviorisme, les périodes dites de localisation, le connexionnisme, la cognition incarnée. D’autres courants émergent. Les sciences cognitives, par exemple. En effet, la science s’est longtemps intéressée aux pathologies du cerveau avant de se pencher sur le fonctionnement du cerveau sain. Un objectif des sciences cognitives est de comprendre comment les neurones s’organisent afin de produire de la conscience et de la pensée.
Pourquoi est-on passé de l’ignorance des sciences cognitives dans la classe à un conflit scientifique portant sur ce qu’il conviendrait de faire dans une classe ? La science, qui se décrit comme objective et neutre par son caractère expérimental, peut-elle l’être réellement lorsqu’il s’agit de penser le cerveau pour l’avenir ?
Comme la science, l’école a été traversée par des courants successifs durant son histoire. Philippe Meirieu l’a bien décrit dans son ouvrage L’école mode d’emploi. L’école connaît également une évolution permanente. Elle est animée par le même dessein que la science : rendre le cerveau plus performant. Leurs modalités sont néanmoins très différentes.
En quoi l’apport de la recherche neuroscientifique s’impose-t-elle à l’école ?
Le verbe « s’imposer » peut évoquer un acte autoritaire. S’agissant de la recherche, il s’agirait d’appliquer de manière injonctive au système scolaire les résultats obtenus. S’imposer peut aussi se comprendre comme une invitation à collaborer avec l’école. En ce cas, nous pourrions aussi inverser l’évidence : l’école devrait-elle s’inviter ou s’imposer dans les laboratoires de recherche ? Le verbe « imposer » est synonyme d’assujettir, de prescrire, d’exiger. J’ai choisi la forme pronominale car dans ce cas, le verbe exprime ce qui est nécessaire, indispensable. Par ailleurs, s’imposer « à » l’école n’est pas s’imposer « dans » l’école.
Il n’est pas question de faire entrer les neurosciences de force dans la classe, mais de déployer un plan de connaissance en tant que ressources afin de penser les apprentissages et par voie de conséquence l’école de demain.

Au cœur de la réflexion sur la connaissance du cerveau à l’école, il est question de ce que l’on veut faire de l’intelligence humaine et du devenir de l’humanité. Après la conquête spatiale et le décryptage du génome, des programmes de recherche internationaux ont été lancés afin de décrypter le code neural, c’est-à-dire le langage dans lequel « dialoguent » les neurones. Grâce aux chercheurs qui travaillent dans le monde entier sur la cartographie du cerveau, nous avançons aujourd’hui très rapidement dans la compréhension du fonctionnement du cerveau. Le connectome peut se définir comme l’ensemble des circuits cérébraux et de leurs connexions. La compréhension du connectome aura des conséquences très importantes pour la médecine du XXIème siècle. Nous pourrons aller bien au-delà des méthodes invasives actuelles, comme la transplantation profonde d’électrodes dans le cerveau. Nous serons sans doute en mesure de développer des techniques qui seconderont les compétences cognitives.
La définition de l’intelligence comme capacité à s’adapter semble aujourd’hui bien restreinte. Au fur et à mesure que progressent les neurosciences, nous savons de moins en moins ce qu’est l’intelligence. La capacité du cerveau ne se mesure pas seulement à sa modification en fonction de son environnement. Elle porte aussi sur le renouvellement de ses logiques de traitement de l’information. Il ne fait pas de doute que les molécules et la technologie numérique puissent l’augmenter. Tel est déjà le cas.
La recherche sur le connectome est possible grâce à l’imagerie cérébrale. Les connaissances acquises sur la mémoire, le système intentionnel, le rôle de la conscience, se sont modifiées ou déplacées. Elles nous incitent à penser aujourd’hui que le cerveau de l’enfant est déjà très puissant à la naissance. Le cerveau du nourrisson est capable de traiter certaines informations très abstraites. Il serait dès la naissance un calculateur de probabilité projetant des hypothèses sur le monde afin de les vérifier. Il compilerait en permanence des statistiques en fonction des informations reçues, comme le ferait un puissant algorithme d’ordinateur. Ces compilations permettent d’anticiper, d’établir des prédictions qui aideront le nourrisson à organiser son monde interne, c’est-à-dire apprendre. En d’autres termes, apprendre ne revient pas seulement à adapter son système neurologique en fonction des informations à traiter. Cela consiste également à modifier ses logiques par anticipation.

Le bébé ne naît pas « tabula rasa ». Il vient au monde avec une capacité de traitement de l’information très élaborée. L’approche du cerveau « statisticien » est aujourd’hui privilégiée dans le champ des sciences cognitives, même s’il lui est reproché d’être un modèle unifié de la cognition humaine.
Quoi qu’il en soit, le cerveau est un organe évolutif, plastique, un puissant narrateur, un interprétateur. Il est projectif, en tant qu’il ne cesse de générer des hypothèses. Il est un simulateur d’action, un « prédicteur » des conséquences de ces actions. Enfin, il est émulateur et transformateur. Il est créateur de sens.
Au cours de ses milliers d’années d’existence, l’humanité s’est forgé des certitudes afin d’expliquer les phénomènes naturels non compréhensibles et pouvoir ainsi se situer au milieu de cet ensemble. Néanmoins, le questionnement sur le réel déplace quelquefois les certitudes. Trois grandes révolutions ont déjà modifié les certitudes humaines. Premièrement, la révolution copernicienne a ôté à l’homme sa place centrale dans l’univers en passant du géocentrisme à l’héliocentrisme. Deuxièmement, la révolution darwinienne lui a retiré sa place de « premier » au sommet de la pyramide du vivant pour le situer au milieu de la chaîne des espèces. Troisièmement, avec Freud, l’homme comprenait que ses pensées et comportements recelaient des coins d’ombre qui lui échappaient et qu’il n’était donc pas seul maître de sa propre personne. Certaines questions demeurent ouvertes aujourd’hui : qui sommes-nous vraiment ? L’homme est-il son propre cerveau ? C’est précisément à cette dernière question que les neurosciences cherchent à répondre à travers les recherches menées sur la conscience.
La quatrième révolution, évoquée par Joël de Rosnay dans son ouvrage Le macrocosme et la révolution systémique, consiste à passer d’une logique analytique à une logique systémique. En d’autres termes, l’homme ne regarde plus le monde par l’étude séparée de ses éléments. Il ajoute à cette vision parcellaire une vision globale, où les relations entre les parties sont plus importantes que les parties prises séparément. Il n’y a pas qu’un seul regard qui puisse dire ce qu’est l’être humain, mais des regards qui se complètent et se nourrissent. Il en va de même de l’intelligence humaine. Elle ne peut se penser seule, tourner autour d’elle-même dans un contexte unique, qu’il s’agisse de l’entreprise, de l’école ou des neurosciences. La réflexion sur l’intelligence humaine doit être partagée par toutes les disciplines. L’école doit s’investir dans cette orientation fondamentale qui concerne l’évolution des êtres humains.
La transmission des savoirs
La révolution de l’intelligence humaine pourrait donc bien être la cinquième révolution de notre humanité. Désormais, l’humain ne se pensera plus seul. Il sera accompagné d’une intelligence artificielle sous des formes diverses. L’humain évolue aujourd’hui dans l’incertitude entre la place qu’il se donne lui-même et ce qu’il confie à la technologie, entre ce qu’il garde et ce qu’il délègue, entre ce que l’intelligence artificielle fait déjà bien plus vite que lui et ce qu’il doit à tout prix conserver en propre afin de ne pas perdre son identité. Il est également confronté à la question « qui prendra le dessus sur l’autre ? ».
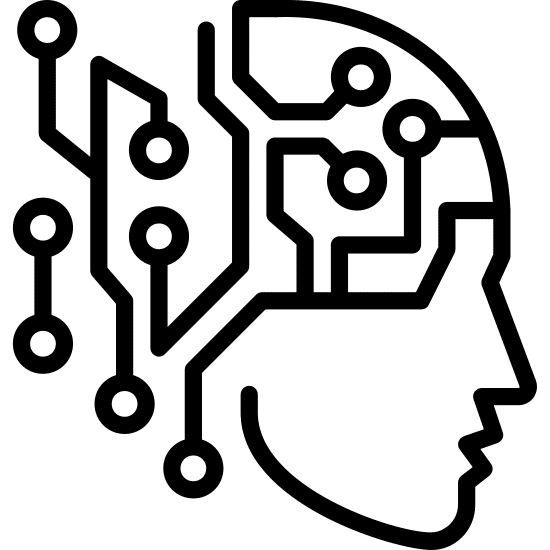
Lorsque nous discutons d’intelligence aujourd’hui, il est toujours nécessaire de préciser de quoi nous parlons. S’agit-il d’intelligence humaine ou d’intelligence artificielle ? Pour certains, l’intelligence artificielle pourrait presque détrôner les sciences cognitives, au sens où elle semble être parfois un moyen d’améliorer le raisonnement. Les avancées des sciences du cerveau nous amènent à présenter une nouvelle vision de la condition humaine tentant de réconcilier notre nature biologique avec une vision humaniste respectueuse de la personne et d’une vie harmonieuse en société. Il sera donc utile de songer à une utilisation responsable des méthodes d’amélioration cognitive, ainsi qu’à une évaluation de la responsabilité pénale fondée sur l’imagerie cérébrale.
Face à la révolution de l’intelligence, l’école ne peut plus se limiter à la transmission des savoirs. Les enseignants doivent participer comme les scientifiques aux décisions à prendre afin que les enfants puissent s’adapter et penser le monde de demain. Les connaissances devront être à disposition de tous les enseignants, mais aussi de tous les élèves. Le problème est que la technologie évolue plus vite que nos représentations et nos connaissances. Dans un système idéal, nous pourrions espérer que tous les enseignants, à la fois ceux qui sont en train de se former et ceux qui exercent déjà, bénéficient d’une formation en sciences cognitives. Mais cela ne peut être le seul moyen de procéder.
Ce qui semble le plus important le plus important n’est pas tant ce que les enseignants comprennent mais ce qu’ils transforment dans la représentation de leur métier. Un projet de neurosciences dans un établissement ne se limite pas à l’acquisition de connaissances sur le fonctionnement du cerveau. Il doit également permettre aux enseignants de s’engager dans un changement profond : l’évolution et la modification des représentations de la capacité d’apprentissage des élèves d’une part, et la façon de concevoir les modalités de coopération entre les personnes et l’organisation générale de l’établissement d’autre part. Il s’agit en somme de rebâtir le projet éducatif afin qu’il soit en accord avec les valeurs humaines que l’éducation cherche à promouvoir.
Chacun de nous perçoit la connaissance selon son expérience, ses certitudes et ses « biais » cognitifs. Il est donc bien improbable que nous percevions tous l’information de façon identique, parce qu’elle est impitoyablement transformée par notre cerveau. Ce dernier nous joue des tours pour deux raisons. Premièrement, il traite l’information avant qu’elle arrive à notre conscience. Deuxièmement, nos biais cognitifs nous préservent de bouleversements qui pourraient s’avérer trop gênants. En d’autres termes, ce qui ne cadre pas avec notre logique ne suscite pas de notre part l’envie de l’examiner de plus près. Plus généralement, aucune discipline n’échappe à ses propres paradigmes. Je rappelle la phrase de George Box : « Tous les modèles scientifiques sont faux, mais certains sont utiles ».
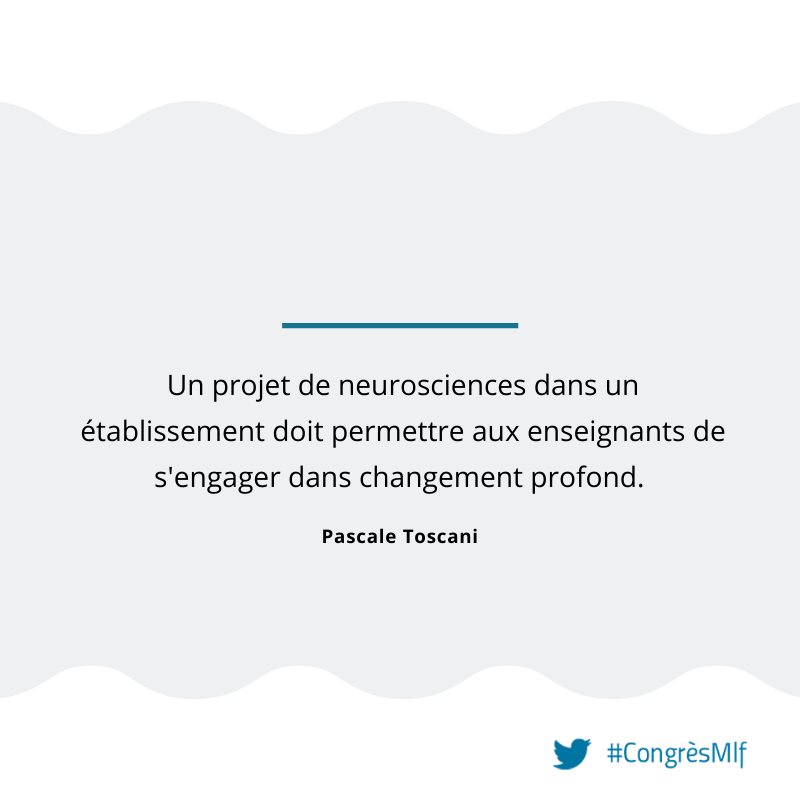
La nouveauté est toujours freinée par des résistances de toutes natures. Celles-ci sont autant de « pépites » qui questionnent à leur tour la science. Nous savons combien les erreurs sont source d’apprentissage pour les élèves. De la même façon, les résistances sont nécessaires à l’évolution des idées dans tous les métiers. Les enseignants se déclarent parfois las de s’entendre dire comment ils doivent enseigner. Ils ont le sentiment d’être de simples agents.
Certains perçoivent les sciences cognitives comme une tentation de définir des lois immuables d’apprentissage en dehors de tout contexte. Les enseignants qui s’intéressent aux sciences cognitives doivent comprendre étape par étape l’attention, la mémoire, l’inhibition et d’autres éléments. Ce qui fait sens, au terme de ce parcours, ce sont surtout les transferts pédagogiques de la science vers l’école et la classe, pour les élèves et avec les élèves.
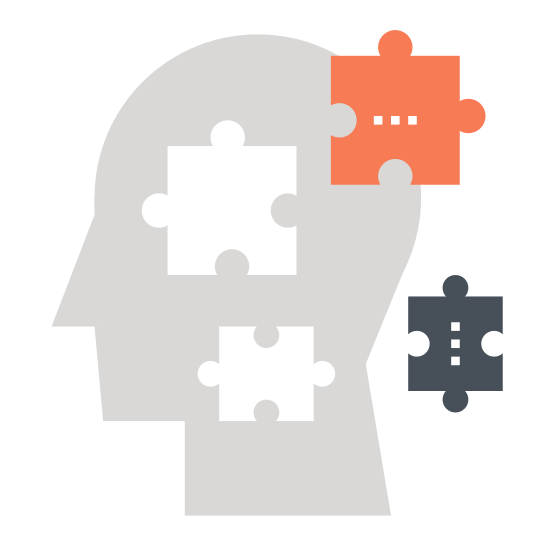
L’apport essentiel des sciences cognitives est ce transfert dans la classe. La réalité du laboratoire n’est pas celle de la classe. Pourtant, chacun, enseignant ou chercheur, détient une partie des réponses aux questions de l’apprentissage, car le cerveau est aussi une symbiose du socioculturel et du biologique. La mémoire, par exemple, appartient aussi bien aux neurosciences qu’aux sciences humaines. Le chercheur en neurosciences examinera comment « coopèrent » les neurones pour constituer la mémoire. L’enseignant, quant à lui, souhaite que les élèves prennent conscience de leur mémoire pour organiser leurs apprentissages.
La disjonction entre les humanités et la science enferme chaque discipline dans une expertise qui peut isoler du contexte. L’éloignement lié à l’expertise finit par faire obstacle à toute forme de solidarité intellectuelle, alors que la recherche devrait être participative, pour une plus grande égalité. L’école est aussi un lieu de recherche et les enseignants sont aussi des chercheurs. Les idées doivent venir de tous les esprits. S’ils se trompent, ils peuvent poursuivre la réflexion autrement. Je ne crois pas qu’il y ait d’un côté l’esprit de la recherche et de l’autre, celui de l’application. Ce sont deux faces d’une même pièce. La recherche scientifique se fonde sur des expérimentations visant à confirmer ou infirmer des hypothèses.
Afin de faire de l’école un lieu de recherche, il est important que les enseignants soient formés à la méthodologie de la recherche. Elle permet de questionner de façon rigoureuse lorsque quelque chose dysfonctionne dans un système. La science est riche de connaissances relatives au fonctionnement neurologique et l’éducation est riche de connaissances concernant l’organisation pédagogique et didactique de l’apprentissage. La collaboration suppose une évaluation des compétences humaines qui ne soit pas essentiellement fondée sur l’analyse quantitative ou objective. Certains aspects échappent toujours à l’analyse. L’individu n’est pas une moyenne aucune conclusion ne peut être tirée sur un individu à partir d’une moyenne.
Nos cellules évoluent comme nous à la recherche d’une homéostasie, c’est-à-dire un équilibre dynamique avec l’ensemble des éléments constituant notre environnement. L’humain est complexe, il s’ « autoproduit » en fonction de son aventure et l’issue de celle-ci est imprévisible. Les neurosciences ne doivent pas nous conduire à nous désintéresser de nous-mêmes en tant qu’individus singuliers. Les sciences humanités, quant à elles, ne doivent pas conduire à mésestimer la puissance du cerveau.
Le neurobiologiste Francisco Varela disait que l’intelligence ne se définit pas comme la faculté de résoudre un problème, mais comme celle de pénétrer un monde partagé. Sa sagesse nous invite à la coopération contre toute tentative d’une nouvelle Babel concernant l’école.

Transcription de la conférence de Pascale Toscani, docteure en psychologie cognitive, au #CongrèsMlf 2019
(Re)voir la conférence