Bilinguisme et biculturalité : pourquoi communiquer est un acte d’identité

Notre langue, nos langues, sont une partie intégrante et définitoire de notre identité. Parler une langue, ce n’est pas seulement connaître son vocabulaire et ses structures : c’est quelque chose de beaucoup plus intime, qui touche à son histoire, ses codes, la culture dans laquelle elle se développe et se déploie ; c’est un savoir forgé dans l’interaction avec d’autres locuteurs, liés par des expériences communes, que ce soit le « goûter » des petits Français ou le « hug » des Américains
Culture et identité
La langue est un outil intrinsèquement social qui s’acquiert par l’échange, dans un contexte donné ; on peut la comparer à une plante : il n’est pas impossible de la faire pousser hors sol, mais avec le bon terreau, elle pousse beaucoup plus vite et surtout, elle crée des racines beaucoup plus solides !
La culture se manifeste de plusieurs façons : dans les règles sociales, croyances, valeurs, traditions, et même les comportements les plus quotidiens. Se serre-t-on la main pour se saluer, ou bien évite-t-on de se toucher ? Se fait-on la bise? Et combien de bises, et par quelle joue commencer ? Aussi anecdotique qu’elle puisse paraître, c’est une question importante. Les pratiques culturelles se manifestent en effet à plusieurs échelles : nation, région, ville, école… D’après Grosjean, en effet, il existe des cultures « majeures » (nationales, linguistiques, religieuses, etc.) et des cultures « mineures » (liées aux métiers, aux sports, aux loisirs, etc.)
Ainsi, non seulement les cultures sont structurantes, mais elles s’imbriquent. Nous naviguons constamment dans plusieurs réseaux sémiotiques de traditions, de croyances, de valeurs. Mais l’hybridation des cultures, des réseaux signifiants, peut poser problème, dans son acquisition comme sa réception ; une difficulté à conceptualiser et accepter l’idée de la légitimité du mélange qui n’est pas nouvelle, loin s’en faut.

Dans l’empire romain où se côtoyaient des dizaines de langues, par exemple, les problématiques culturelles et identitaires venaient se superposer aux problématiques linguistiques : pour certains Romains, parler grec était à la fois désirable parce que c’était une langue prestigieuse, et indésirable parce que cela revenait à souligner que le modèle hellénique demeurait l’incarnation de la civilisation. Parler grec, c’était renier la romanité : la langue était dépossédée de son caractère premier de véhicule linguistique pour être revêtue à son corps défendant des atours de la patrie. C’est un paradoxe qui traverse les âges et les sociétés, et que l’on retrouve par exemple régulièrement aux États-Unis, où l’anglais a été érigé en symbole d’américanité. Ceci fut accentué par la première Guerre Mondiale, atteignant un paroxysme en Iowa, où le gouverneur William L. Harding signa le 23 mai 1918 la « Proclamation Babel », qui interdisait l’emploi de langues autres que l’anglais dans les lieux publics. Le multilinguisme devenait ainsi la source et la cristallisation de crispations identitaires.
Ce rejet reflète un mouvement global à l’échelle de l’Histoire mondiale. Le début de l’Histoire est en quelque sorte babélien : une myriade de petites entités politiques avec chacune ses pratiques culturelles et linguistiques. Puis il se produit la réunion de ces petites entités politiques en agglomérats plus grands, mouvement qui s’est toujours accompagné de deux conséquences linguistiques.
Premièrement, dans le cas de la conquête, le plus fréquent dans l’Histoire, une langue acquiert un nouveau territoire d’utilisation, déjà occupé par une autre, et la supplante : les dialectes anglo-saxons ont presque fait disparaître les langues celtiques en Angleterre au cinquième siècle, langues celtes qui avaient déjà subi le même sort sur le territoire français avec la conquête romaine.
Deuxièmement, la construction des États-nations s’est souvent accompagnée de tentatives de passage du multiple à l’unique, de manière à garantir que les décisions du pouvoir puissent être comprises de tous. Exemple bien connu en France : l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, dont le célèbre article 111 exige que les actes administratifs et de justice « soient prononcez, enregistrez & deliurez aux parties en langage maternel francoys, et non autrement ».
L’Académie française, au siècle suivant, viendra définitivement entériner ce mariage entre la langue et l’identité françaises : une triade est ainsi créée, langue, peuple, culture, et le français acquiert ainsi une mythologie au sens de Barthes. Le français devient un objet, et qui plus est un objet à défendre, qui doit rassembler ceux qui le parlent derrière cette cause commune.
C’est une idée que l’on retrouve en 1917 dans la formule « Lingua gentem facit » d’Onésime Reclus, formule écrite, de façon assez ironique pour un des pères de la francophonie, en latin. La langue fait le peuple. Les langues et la question de savoir lesquelles parler ou ne pas parler deviennent ainsi un sujet fondamental dans les problématiques liées aux processus de développement communautaire. Les discours idéologiques viennent pointer ce qui serait une incompatibilité théorique entre construction de la nation et les situations de plurilinguisme, comme s’il était indispensable de choisir – comme si les identités à trait d’union, pour reprendre le concept américain, ne pouvaient être des identités en soi : c’est une entreprise de déshybridation des identités.
L’identité, un lien social
l’identité est à la fois personnelle (nous sommes tous des individus) et sociale (nous n’existons pas hors la masse des personnes et des croyances qui nous ont forgés). Ce postulat peut être rattaché au concept de « communauté imaginée » (Anderson 1983), dont s’inspire Cohen (1985) pour proposer un modèle dans lequel une communauté est le résultat d’une construction, axée autour d’un répertoire symbolique commun. Dans les communautés bilingues, ce répertoire symbolique comprend les deux langues partagées, qui ne sont donc pas que des médiateurs, mais également des symboles, au sens premier du terme.
Qu’est-ce qu’une langue en effet ? L’une des toutes premières choses partagées. C’est quelque chose que l’on apprend dans l’interaction, dans des contextes bien précis, foyer, école, clubs, etc. Ce concept d’interaction dans la langue est primordial. Une langue n’est pas qu’une liste de mots et de règles de grammaire ; c’est aussi une liste de constructions culturelles, de codes, de règles et de contextes d’usage, qui émergent en lien avec les expériences partagées d’individus liés par des pratiques communes. Les langues sont forgées et reforgées en permanence par l’usage de ceux qui les parlent. Les discussions récentes en France autour des anglicismes et du langage inclusif sont symptomatiques du fait que le médium linguistique et les mondes qu’il dit se confondent : la langue est gorgée de nos représentations culturelles, et inévitablement les transformations culturelles révèlent les sédiments laissés par les strates précédentes. Nos langues sont ainsi associées à des représentations culturelles plus ou moins conscientes, et les conscientiser permet de montrer à quel point les langues ne sont pas neutres. On trouve ainsi des représentations stéréotypées qui lient les langues et les peuples. Les dialectes régionaux, qui ne sont pas considérés comme standard, charrient leur lot de connotations qui sont éminemment culturelles et ne reposent sur rien : l’accent belge, par exemple, est encore aujourd’hui largement moqué des Français.

Or la parole est un outil de construction de l’ethos, c’est-à-dire l’image que l’on projette de soi. Cette image passe par multiples dimensions : la posture physique, le choix de vêtements, le volume ou la qualité de la voix, par exemple, mais également et peut-être surtout, les choix linguistiques : dialecte, accent, choix de mots, de tournures de phrase… L’ethos change en fonction des contextes et des buts à atteindre (on ne se présente pas de la même façon à son employeur ou à ses amis), mais il entre forcément en résonance avec diverses normes culturelles : on ne choisit pas n’importe quelle image de soi, au risque d’être exclu. C’est ce que l’on retrouve avec le concept anglais du « peer pressure » : la pression que l’on ressent, notamment à l’école, pour se montrer conforme aux normes du groupe.
Il y a une norme, justement, qui est peut-être universelle : c’est celle qui dicte qu’il faut éviter de risquer de faire perdre la face à ses interlocuteurs. Tout le monde ne s’y conforme pas forcément : on peut choisir de la respecter ou de l’ignorer en fonction des buts que l’on cherche à atteindre. On peut par exemple décider de placer son interlocuteur dans une situation d’infériorité linguistique. Par exemple, dans le cadre du bilinguisme, on peut choisir d’exclure quelqu’un en parlant une langue dont on sait que l’autre ne la comprend pas. Que cela soit fait consciemment ou non, cette cohabitation linguistique n’est pas sans conséquences : le 8 mai 2019, le Washington Post publiait une étude du Pew Research Center selon laquelle 47% des Républicains, aux États-Unis, sont gênés à l’idée d’entendre parler des langues étrangères dans des lieux publics.

C’est que la langue est un véritable acte d’identité. Une personne construit son identité non seulement en faisant siens les lieux communs tribaux partagés par le groupe, mais également en se servant de l’autre comme d’un repoussoir : ce que la personne n’est pas la définit tout autant que ce qu’elle est. D’où la glottophobie, le linguicisme – l’exclusion de l’autre de par la langue qu’il parle –, l’insécurité linguistique…
Chez les bilingues, cette idée clé se traduit dans la dialectique du « we- code vs. they-code » (Gumperz 1982) : les langues permettent de savoir qui appartient au groupe (nous) et qui y est étranger (eux). Cette identité linguistique duelle peut trouver un terrain d’expression particulier dans les pratiques d’alternance codique, l’utilisation conjointe de deux langues dans une même conversation, qui est logiquement l’apanage de communautés pour lesquelles le bilinguisme représente la normalité linguistique. Le choix d’un code résulte de l’évaluation de son degré d’adaptation aux groupes en présence. En fonction du regard de l’autre, l’alternance codique peut être perçue comme un outil de communication non problématique ou bien comme un artifice identitaire destiné à exclure ou véhiculer une forme de supériorité linguistique.
Chez les bilingues et les biculturels, ces problématiques soulèvent souvent la question de l’assimilation incomplète et de l’hybridation. Quelqu’un qui parle deux langues peut sembler difficile à cerner, a fortiori s’il parle ces deux langues en même temps. Point d’autant plus délicat que l’on pourrait légitimement penser que tout peut être dit dans une langue. Partant, si ce besoin d’alterner ne vient pas de la langue, c’est qu’il vient des personnes.
En dépit de décennies de recherches universitaires, le multilinguisme demeure aujourd’hui encore la cible de nombreux discours négatifs, qu’il soit interprété comme une démonstration malvenue de capital culturel ou bien comme un refus de s’intégrer. Le concept de domaine d’emploi de la langue (Fishman 1972), permet de comprendre comment les pratiques multilingues peuvent paraître littéralement « dé-placées » dans certains contextes. Tandis qu’un domaine implique des interactions typiques entre des participants typiques dans un cadre typique, les locuteurs multilingues se trouvent souvent à cheval entre plusieurs domaines, représentant ainsi une altérité potentiellement menaçante, et ce d’autant plus que de nombreux mythes autour du bilinguisme subsistent, qu’il s’agisse du bilinguisme dit « de prestige » ou « d’héritage ». Les significations et stigmates sociaux ainsi associés au contact des langues ont un rôle à jouer dans l’invisibilisation, qui confine parfois à la ghettoïsation, des répertoires qui sont perçus comme non-standards, ainsi que des identités qui leur sont liées. Or les enfants multilingues grandissent en faisant l’expérience de l’altérité linguistique, car ils doivent apprendre où ils peuvent (ou non) déployer toute leur compétence linguistique. En parallèle au processus d’acquisition de la langue, ils apprennent ainsi à faire varier leur bilinguisme momentanément en fonction des interlocuteurs et des contextes. La gestion des interactions fait partie intégrante de l’acquisition des langues en contexte bilingue : il y a une véritable culture de « l’être-bilingue ».
Chez les enfants, ces questions peuvent être source d’interrogations, voire de rejet, le bilinguisme étant plus souvent l’exception que la norme en Occident. Or un enfant n’aime pas se sentir différent. On en revient au lien entre langue et culture, et plus spécifiquement la culture du monolinguisme. Le 5 mai 2019, le journal anglais The Telegraph révélait ainsi qu’un nombre important d’enfants au Royaume-Uni trouve les cours de langues si stressants qu’ils s’en font dispenser par un médecin : pas étonnant dès lors que les enfants bilingues soient perçus par beaucoup de gens comme des êtres à part !
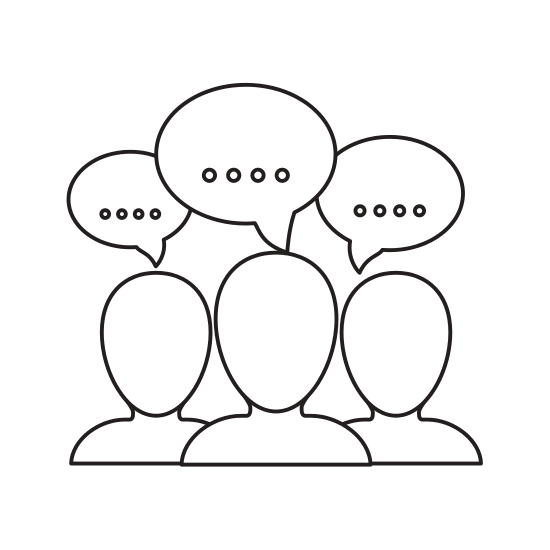
La langue est par ailleurs vécue comme un symbole identitaire. Si elle vient à identifier quelqu’un que l’enfant rejette, elle sera rejetée de même. Si un enfant cesse brusquement de parler une de ses deux langues, c’est potentiellement l’indicateur d’un conflit. Ceci se retrouve dans le Concept de l’Instinct Interactionnel développé par Lee et al. (2009), selon lequel il existe une nécessité biologique chez les enfants de s’attacher aux autres et de chercher l’interaction verbale avec les personnes qui s’occupent d’eux pour devenir des locuteurs compétents. Comme ils l’écrivent, « The structures of language emerge from interrelated patterns of experience, social interaction, and cognitive mechanisms ». D’où l’importance de créer une bulle représentationnelle d’interaction positive.
Coste, Moore & Zarate (2009) insistent ainsi sur l’importance de l’acquisition et du développement d’une compétence à la fois plurilingue et pluriculturelle : « On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle la compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement possédée par un locuteur qui maitrise, à des degrés divers, plusieurs langues et a, à des degrés divers, l’expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer l’ensemble de ce capital langagier et culturel. »
On rappellera pour conclure qu’une langue est un système sémiotique qui dit et interprète le monde et les relations interpersonnelles. Ma langue, mes langues, sont mon lien au monde qui m’entoure et aux miens. Nous avons tous des identités plurielles . Le bilinguisme n’en est qu’un exemple plus visible, ou plus audible, que d’autres. Rien n’empêche même en soi d’hybrider les langues, si ce n’est la peur du regard de l’autre. Mais ceci nécessite verbalisation, attention, soutien, des modèles positifs à imiter, et de la motivation. Grosjean (2011) rapporte un proverbe tchèque : « Apprendre une nouvelle langue, c’est acquérir une nouvelle âme ». C’est en tous cas une nouvelle façon de voir les réseaux signifiants qui traduisent notre place dans le monde.
Nous vivons paradoxalement une époque de repli identitaire alors que les brassages n’ont jamais été aussi intenses. Il faut se défaire des discours sur la pureté de la langue et la pureté de la culture. Ce ne sont pas des objets, mais des processus, que nous réinventons en permanence. À nous de donner à nos enfants et nos élèves l’espace nécessaire pour hybrider et déployer toute leur identité en toute confiance.
Transcription de l’atelier de Charles Brasart, docteur en linguistique, spécialiste du bilinguisme et Maître de Conférences à l’Université de Nantes au #CongrèsMlf 2019
(Re)voir la conférence
Ressource